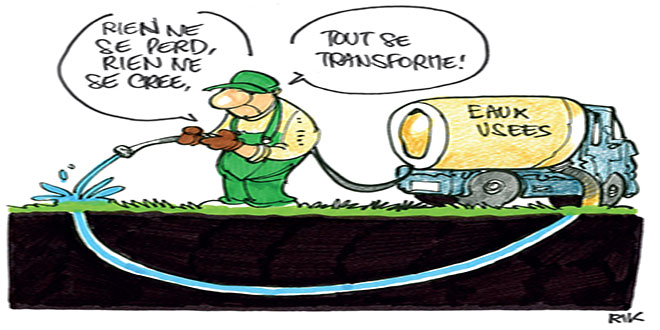Patrick Eveno est spécialiste de l’histoire des médias, professeur émérite après avoir été maître de conférences et professeur des universités à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Enseignant dans les écoles de journalisme (ESJ de Lille, IPJ Paris), il est aussi expert auprès du ministère de la Culture pour les missions de réforme des aides à la presse
Un journaliste de l’agence de presse Reuters a été tué dans le sud du Liban le samedi 7 octobre et six autres ont été blessés, après que les forces israéliennes ont bombardé cette zone suite à une «tentative d’infiltration». Le 9 mai 2023, un journaliste coordinateur vidéo de l’AFP en Ukraine avait été tué lors d’une frappe de roquettes russe à proximité de Bakhmout. Présent en Ukraine depuis quinze mois, il se rendait très régulièrement sur le front, en dépit des difficultés d’informer dans des conditions de guerre.
Reporters sans frontières dresse chaque année une liste de ces journalistes tués au service du public: le chiffre, en moyenne 80, dépasse parfois la centaine. Le prix Bayeux des reporters de guerre décerne chaque année des distinctions aux correspondants de guerre, et les stèles du mémorial entretiennent la mémoire de plus de 2.000 journalistes tués dans l’exercice de leur métier. Dans ce contexte dramatique, revenons brièvement sur l’histoire du journalisme de guerre et sur l’évolution récente de ce métier pas comme les autres.
Les reporters situés
En temps de paix, le journaliste peut aisément se situer: reporter ou enquêteur, il décrit les événements, fait passer de l’émotion, raconte la vie des autres à ses lecteurs; éditorialiste ou chroniqueur, il prend position pour éclairer le public ou tenter de l’endoctriner. Mais en temps de guerre, de quel côté est-il: du côté des guerriers ou du côté des victimes? Dans quel camp se situe-t-il? Est-il possible d’être entre les lignes et de maintenir l’équilibre entre les belligérants, entre l’arrière et le front, entre les politiques et les militaires?

Le reportage de guerre est apparu dans la deuxième moitié du XIXe siècle, lors de la guerre de Sécession aux États-Unis, de la guerre de 1870, mais il prend une place considérable au XXe siècle avec la guerre russo-japonaise, la guerre d’Espagne, les deux guerres mondiales, puis les guerres de décolonisation. En temps de guerre, le journaliste risque souvent d’être considéré comme un espion ou comme un traître; il peut alors être pris en otage, torturé ou tué. Durant la guerre russo-japonaise en 1904-1905, Ludovic Naudeau, envoyé spécial du Journal, est du côté des Russes; il est arrêté par les Japonais pour espionnage. En 1917-1918, il couvre la révolution russe pour Le Temps; il est arrêté en juillet 1918 à cause de la teneur antibolchévique de ses articles. Il est libéré à la fin de l’année en échange de la publication dans Le Temps d’un entretien avec Lénine.
De nombreux journalistes sont morts pour avoir tenté de faire leur travail d’information, tels André Leveuf, tué au Maroc le 20 août 1955 ou Jean-Pierre Pedrazzini et Jean Roy, reporters pour Paris Match, tués à l’automne 1956, l’un à Suez, l’autre à Budapest. Durant la guerre d’Espagne, la presse française envoie près de deux cents reporters et photographes pour couvrir cette guerre civile annonciatrice de la Seconde Guerre mondiale: dans les premières semaines, les envoyés spéciaux circulent entre les deux camps; mais bientôt, devant les menaces, les journaux d’information sont contraints d’envoyer deux équipes séparées pour couvrir les deux camps. Plusieurs correspondants meurent en Espagne, dans les combats ou par accident, et certains sont fusillés.
C’est à cette époque que la quête de l’image, fixe puis animée, prend une importance capitale pour apporter des preuves visuelles et conforter les reportages écrits. Il faut alors être au plus près: Gerda Taro meurt en Espagne; Robert Capa, qui a débarqué avec l’armée américaine le 6 juin 1944 en Normandie et a été tué au Tonkin en 1954, disait: «Si la photo n’est pas bonne, c’est que vous n’êtes pas assez près».
De la différence avec «tous reporters»
Depuis 2005, les smartphones et les réseaux sociaux ont permis l’émergence de simples citoyens qui se présentent parfois comme reporters. «Tous journalistes», mais aussi tous photographes et tous vidéastes est un slogan qui a fait son apparition avec les nouvelles technologies de communication et de diffusion, en partie pour discréditer les médias traditionnels, qui seraient trop éloignés des réalités vécues.
Pourtant, le slogan est trompeur: les journalistes, même les pigistes, sont insérés dans une rédaction, ce qui leur permet d’être épaulés, matériellement et intellectuellement: ils bénéficient de moyens de protection (casques, gilets pare-balles, etc.) et de relecteurs et vérificateurs qui corrigent, approfondissent et valident les reportages; ils s’appuient également sur des règles déontologiques reconnues par la profession qui encadrent les pratiques.
Les plus importantes, dans un contexte de guerre, étant la fiabilité et le croisement des sources, la vérification et la contextualisation des informations, et enfin, la détection des liens d’intérêts et des manipulations éventuelles. Pierre Ganz, un des spécialistes français de la déontologie journalistique, affirme: «Les documents qui circulent en très grand nombre sur les réseaux sociaux ne peuvent être repris par les médias sans recoupement et authentification par des méthodes journalistiques. L’analyse de ces renseignements [dits OSINT, pour open source intelligence en anglais] demande des équipes composées d’informaticiens et de journalistes, ou par des sites spécialisés comme Bellingcat.» Le reporter de guerre n’est pas sur le front pour témoigner sans recul, mais pour documenter, afin que les opinions publiques aient une image claire, aussi proche que possible de la réalité et de la vérité du terrain, ainsi que du contexte de la guerre. C’est pourquoi le régime de Vladimir Poutine (comme d’autres régimes autoritaires) mène de longue date une guerre sans merci aux journalistes professionnels et aux médias indépendants, ce qui lui permet de diffuser massivement ses «fake news».
L’information, un enjeu dans la guerre
La Première Guerre mondiale inaugure la «guerre totale», aussi bien militaire qu’économique ou idéologique. Afin de mieux contrôler l’information, les armées enrôlent des journalistes qui partagent la vie des soldats; ce sont les «embedded», selon la formule américaine. Mais, bien souvent, ils regimbent: ainsi, en 1918, Albert Londres quitte le groupe des reporters encadrés, les «brassards verts». C’est là un moyen d’éviter la censure militaire directe, que les journaux n’aiment guère. Photographes, cinéastes et journalistes officiels suivent ainsi les armées durant les deux guerres mondiales et les guerres coloniales. La rupture intervient avec la guerre du Vietnam, lors de laquelle plus d’une centaine de journalistes sont tués, parce que l’armée américaine laisse plus de libertés aux très nombreux photographes et vidéastes (plus de 600 en 1968). Des reportages et des photographies, telle «la petite fille au napalm» de Nick Ut (qui lui vaut le prix Pulitzer 1973), contribuent à discréditer la guerre auprès de l’opinion publique américaine. L’armée américaine reprendra le contrôle, notamment pendant la guerre du Golfe (1991), la dernière avant l’irruption d’Internet. Les reporters de guerre, bien qu’ils soient souvent instrumentalisés au service des diverses propagandes, sont «les yeux et les oreilles» des militaires, des populations civiles concernées par la guerre, mais aussi de l’opinion publique mondiale.
Albert Londres disait: «Nous allons voir pour vous». Il s’agit de documenter, non de témoigner comme le font les civils ou les soldats engagés dans un conflit. Il s’agit aussi de raconter le vécu des civils et des soldats, pas simplement de filmer des explosions ou des ruines. Se pose alors la question de ce qu’il faut montrer, ou pas, et pourquoi: dans l’invasion russe qui ravage l’Ukraine, les autorités ukrainiennes imposent aux reporters de ne pas montrer d’éléments susceptibles de permettre l’identification des lieux de tournage, car les Russes les regardent pour déterminer leurs cibles. Montrer des morts est aussi un dilemme très ancien: Le Miroir, le 8 octobre 1916, affiche les corps enchevêtrés d’un soldat français et d’un soldat allemand. Dès 1862, Alexander Gardner publie des photos de la guerre de Sécession. Les reporters contemporains ont souvent plus de pudeur avec les victimes: il n’est pas nécessaire d’exhiber le sang pour raconter une histoire qui intéresse le public, parce qu’il faut éviter le phénomène de lassitude qui gagne à mesure que se prolonge la guerre. C’est pourquoi les reporters, hommes et femmes, de plus en plus nombreuses sur les fronts, varient les angles et les modes de récits.
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation